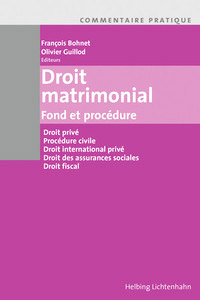Newsletter
En ce début d’année 2025, que nous vous souhaitons d'ores et déjà pleine de joie, de succès et de belles découvertes, nous vous proposons une édition spéciale de la newsletter droitmatrimonial.ch, qui revient sur les arrêts commentés en 2024.
Janvier 2024
TF 5A_108/2023 (f) du 20 septembre 2023
Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 58, 85, 232 et 235 CPC
Exception à l’obligation de chiffrer les conclusions (art. 85 CPC) – rappel de principes généraux. Si une partie a besoin que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande et dépose dans un premier temps des conclusions non chiffrées, elle doit chiffrer sa prétention et alléguer les faits qui la sous-tendent « dès que possible », soit à la première occasion procédurale qui suit directement la phase d’administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales (consid. 5.2.1), et ce, au plus tard au premier tour de parole, si elles sont faites par oral (consid. 6.2.3).
Rappel des raisons (compétence matérielle, type de procédure, avance de frais) pour lesquelles la partie demanderesse doit indiquer un montant minimal (adaptable ultérieurement) comme valeur litigieuse provisoire au moment de l’introduction de l’action. Rappel d’une jurisprudence où l’exigence de chiffrage d’un montant minimal a été considérée comme du formalisme excessif dans les circonstances du cas alors traité (consid. 5.2.1).
Idem – en procédure de divorce. Rappel de principes (déroulement de la procédure sur demande unilatérale de divorce, actio duplex, exigence de chiffrage des conclusions en versement d’une somme d’argent). En procédure de divorce, la partie défenderesse étant habilitée à déposer ses propres conclusions indépendantes en liquidation du régime matrimonial (actio duplex) et pouvant rencontrer les mêmes difficultés de chiffrage que la partie demanderesse, elle a également le droit de déposer des conclusions non chiffrées aux conditions de l’art. 85 al. 1 CPC. Elle n’est toutefois pas tenue d’indiquer une valeur litigieuse minimale provisoire. Elle doit aussi chiffrer ses conclusions au plus tard lors des plaidoiries finales (consid. 5.2.2).
Admission de notes de plaidoiries lors de plaidoiries orales (art. 232 CPC) - question laissée ouverte. Rappel du Message relatif au CPC qui interdit la remise de notes de plaidoiries complémentaires lorsque les plaidoiries sont tenues oralement. Précision selon laquelle une majorité de la doctrine admet (avec ou sans conditions) les notes de plaidoiries. Le principal problème soulevé par l’admission des notes est que celle-ci contreviendrait à l’égalité des armes. L’importance des notes de plaidoiries est réduite du fait que les plaideurs et plaideuses y font une proposition de subsomption, alors même que le tribunal doit y procéder d’office (consid. 6.2.1).
Rappel de principes relatifs à la tenue des procès-verbaux d’audience et notamment leurs buts quant aux allégations des parties (art. 235 CPC) (consid. 6.2.2). Lorsque les parties chiffrent leurs conclusions et les allégués qui les sous-tendent lors des plaidoiries orales, l’autorité judiciaire doit protocoler ces éléments dans leur substance, étant rappelé que le Tribunal fédéral n’a pas exigé une séparation rigoureuse entre les conclusions chiffrées et les allégués y relatifs, et les autres développements de la plaidoirie. Le plaideur ou la plaideuse peut néanmoins – et devrait – procéder à une dictée de ces points au procès-verbal avant d’avancer la suite de la plaidoirie (consid. 6.2.3).
Le tribunal n’est certes pas tenu d’interpeller la partie qui omet de chiffrer ses conclusions alors qu’elle devrait le faire en application de l’art. 85 al. 2 CPC. En revanche, il doit interpeller la partie pour lui donner l’occasion de rectifier la forme par laquelle elle procède devant lui à cette fin ; par exemple dans le cas où des notes de plaidoiries ne seraient pas admises dans le cadre des plaidoiries orales (consid. 6.3). En l’occurrence, l’égalité des armes a été jugée comme respectée compte tenu des circonstances du cas d’espèce et nonobstant l’impossibilité de la partie adverse de déposer également des notes de plaidoiries (consid. 6.3).
Maxime de disposition (art. 58 CPC). Rappel du principe général et rappel de la jurisprudence selon laquelle la maxime de disposition n’interdit pas à l’autorité judiciaire de déterminer le sens véritable des conclusions et de procéder à une interprétation objective selon les principes généraux et selon la bonne foi, à la lumière de la motivation (consid. 7.2).
In casu, la seconde instance cantonale n’a pas violé la maxime de disposition en interprétant qu’en n’accordant pas la propriété du bien-fonds, revendiquée par l’épouse et sur la base de laquelle cette dernière avait chiffré ses conclusions, celle-ci revendiquait, en cas de succombance sur ce point, une soulte de liquidation du régime matrimonial plus importante, et ce, nonobstant l’absence de conclusion éventuelle à ce propos (consid. 7.3).




Commentaire de l'arrêt TF 5A_108/2023 (f)
François Bohnet
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
Février 2024
ATF 150 III 97 - TF 5A_33/2023 (d) du 20 décembre 2023
Divorce; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 285 let. d et 296 al. 3 CPC; 133 al. 1 ch. 1 et al. 2, 296, 298 al. 1 et 2ter, 298b al. 3ter et 301 al. 1 et 1bis CC
Représentation d’enfants en procédure. Rappel de la jurisprudence selon laquelle le/la représentant·e de l’enfant désigné·e dans la procédure pénale en tant que tel·le peut également exercer sa fonction, dans la mesure du nécessaire, devant le Tribunal fédéral ; il/elle est indemnisé·e en conséquence (consid. 1.2.1). Dès lors qu’un·e représentant·e des enfants en procédure a été nommé·e, les parents perdent le pouvoir d’agir pour les enfants dans la procédure et ne peuvent conséquemment pas faire valoir une éventuelle violation du droit d’être entendu·es des enfants (consid. 1.2.3).
Autorité parentale (art. 133 al. 1 ch. 1, 296 et 298 al. 1 CC). Rappel de principes relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive en dérogation au principe de l’autorité parentale conjointe (consid. 4.2).
Garde partagée (art. 298 al. 2ter et 298b al. 3ter CC). De longue date, soit selon l’ancien droit et selon le droit actuellement en vigueur, la garde alternée n’est possible que dans le cadre de l’autorité parentale conjointe ; elle ne peut donc pas être ordonnée dans les cas où l’autorité parentale est exercée par un seul des parents. Ainsi, un parent ne peut pas avoir la garde sans détenir également l’autorité parentale (consid. 4.3.1).
Rappel du fait qu’un accord entre les parents sur les questions relatives aux enfants ne peut pas lier l’autorité judiciaire (art. 296 al. 3 CPC) et qu’il a uniquement le caractère d’une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC), laquelle est guidée par le bien de l’enfant et dépend donc notamment des capacités éducatives, de communication et de collaboration des parents (consid. 4.3.2).
Rappel du fait que l’autorité parentale et la garde ne concernent pas les mêmes domaines (art. 301 al. 1 et 1bis CC) et précision selon laquelle il n’est pas possible de tirer des conclusions directes d’un domaine à l’autre (consid. 4.3.3).
En l’occurrence, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il était contraire au droit d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère malgré la garde alternée choisie par les parties par convention partielle conclue en première instance, laquelle ne faisait pas l’objet du recours (consid. 4.3 et 4.3.3). L’arrêt attaqué a été annulé et renvoyé pour nouvelle décision afin qu’il soit examiné – au vu du conflit parental établi par l’instance précédente – si, tout en maintenant l’autorité parentale conjointe, l’attribution d’un pouvoir de décision exclusif à l’un des parents se justifie éventuellement dans certains domaines (consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a rappelé que comme le règlement de la garde n’avait pas été contesté devant lui, cette question ne pouvait plus non plus être traitée après le renvoi de l’affaire à l’instance précédente (consid. 4.4).






Commentaire de l'arrêt ATF 150 III 97 - TF 5A_33/2023 (d)
Lorsque l’attribution de l’autorité parentale influence la garde partagée et vice versaMars 2024
ATF 150 III 49 - TF 5A_375/2023 (d) du 21 novembre 2023
Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 90 et 93 al. 1 LTF; 273 al. 2, 275 al. 3, 301 al. 1 et 307 al. 3 CC
Instructions de l’APEA aux parents (art. 273 al. 2 et 307 al. 3 CC) – procédure. En l’occurrence, le père, qui purge une peine privative de liberté pour infractions sexuelles graves telles que le viol de la demi-sœur de l’enfant (consid. A.), a demandé à l’APEA de pouvoir exercer des relations personnelles avec son fils (consid. C.c et 1.2). Dans ce contexte, avant de traiter cette question, l’APEA a estimé que l’enfant devait être informé de la situation pénale concernant son père et a donc enjoint la mère de l’informer – par l’intermédiaire d’un service de pédopsychiatrie. Les autorités cantonales du cas d’espèce envisagent cela comme une étape préliminaire à un éventuel droit de visite ultérieur et considèrent que cette information est importante pour le développement de la personnalité de l’enfant, et ce, indépendamment du litige relatif au droit de visite. Dès lors, l’injonction faite à la mère par l’APEA est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF et non une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF) dans le cadre de la procédure relative à l’exercice des relations personnelles (consid. 1.2).
Idem – rappel de principes et précisions. L’art. 273 al. 2 CC correspond à l’art. 307 al. 3 CC dans le sens où les deux dispositions visent à donner des instructions aux parents en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, si tant est que le bien de l’enfant est menacé et que les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou ne sont pas en mesure de le faire (consid. 3.3.1 et 3.4.2).
Rappel de jurisprudences sur diverses instructions, interdictions et obligations faites aux parents (gardiens ou non) en application de l’art. 273 al. 2 CC et qui peuvent être de natures diverses, cas échéant assorties d’une menace de peine. A titre d’exemple, les parents peuvent être enjoints de suivre une thérapie pour améliorer la communication ou éviter de placer l’enfant dans un conflit de loyauté, ou de mettre une thérapie en place pour l’enfant. Les contacts avec les enfants peuvent être interdits en dehors du droit de visite, sans la présence d’une personne de confiance ou en-dehors de la Suisse. Un parent peut être contraint de déposer ses propres documents de voyage ou ceux de l’enfant, voire de se procurer des visas pour l’enfant afin de permettre l’exercice du droit de visite. L’autorité peut ordonner une action, une omission ou une tolérance concrète pour le bien de l’enfant (consid. 3.3.2).
L’art. 273 al. 2 CC sert spécifiquement à aménager les relations personnelles dans l’intérêt de l’enfant, afin de contrecarrer des déficits parentaux dans la mise en œuvre des contacts (consid. 3.3.1, 3.3.2 et 3.4.1). Le droit d’instruction au sens de l’art. 273 al. 2 CC est lié à une réglementation des relations personnelles par l’autorité ; à défaut d’une telle réglementation, le parent détenant l’autorité parentale ou la garde décide de l’exercice et de l’étendue du droit de visite de l’autre parent (art. 275 al. 3 CC). L’art. 273 al. 2 CC ne peut dès lors pas être utilisé comme base légale pour donner l’ordre d’informer un enfant au sujet de son père, que ce soit en prémisse d’une éventuelle réglementation des relations personnelles ou non (consid. 3.4.1).
En conséquence, le Tribunal fédéral s’est demandé s’il se justifiait in casu de donner l’instruction querellée sur la base de l’art. 307 al. 3 CC et a jugé que l’autorité inférieure a confondu, en violation du droit fédéral, la conséquence juridique (la mesure, soit l’instruction donnée à la mère) et l’état de fait de mise en danger (consid. 3.4.2).
Idem – mise en danger de l’enfant. Rappel de principes et précisions. La mise en danger du bien de l’enfant – dont la cause est sans importance – s’évalue selon les circonstances du cas d’espèce ; elle est admise si une possibilité sérieuse d’atteinte au bien-être physique, psychique ou spirituel est concrètement constatée, même si des éléments pronostics doivent régulièrement être pris en compte (consid. 3.3.3).
En l’occurrence, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il fallait en premier lieu examiner si l’enfant a déjà atteint la maturité qui présuppose une confrontation avec les raisons de l’incarcération de son père et une réflexion sur ces faits ; tant que ce n’est pas le cas, la renonciation à la divulgation de l’information ne peut pas apparaître comme une mise en danger du bien-être de l’enfant. La réflexion abstraite selon laquelle l’enfant sera de toute façon confronté tôt ou tard à cette thématique et que ne pas lui en parler ne ferait que repousser la confrontation ne peut pas remplacer à elle seule des constatations concrètes sur la situation personnelle de l’enfant (consid. 3.4.2).
Idem – proportionnalité des mesures. Rappel de principes et précisions. Si le bien de l’enfant est menacé, des mesures proportionnées visant à écarter le danger doivent être mises en place. Une telle ingérence dans les droits parentaux (art. 301 al. 1 CC) doit donc être appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible pour faire face à dite mise en danger. La proportionnalité requiert un rapport raisonnable entre but et effet de la mesure envisagée. C’est-à-dire qu’il convient d’examiner quelles seront les conséquences de l’intervention en soi appropriée et nécessaire pour la personne concernée et si l’on peut exiger d’elle qu’elle la tolère (consid. 3.3.3 et 3.4.3). Les mesures prises ne doivent par ailleurs pas remplacer les efforts des parents, mais les compléter (consid. 3.3.3).
En l’espèce, même si la mise en danger de l’enfant n’a pas pu être établie faute d’instruction suffisante (consid. 3.4.2), le Tribunal fédéral estime que la proportionnalité n’aurait de toute façon pas été donnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce (consid. 3.4.3). Le Tribunal fédéral a en outre remis en question la possibilité de demander un rapport de l’institution de pédopsychiatrie en cas de non-collaboration de la part de la mère (consid. C.c et 3.4.3), compte tenu du secret professionnel du personnel soignant (consid. 3.4.3).






Commentaire de l'arrêt ATF 150 III 49 - TF 5A_375/2023 (d)
Gaëlle Droz-Sauthier
Dre en droit, Maître-assistante à l’Institut de la famille, Université de Fribourg, Avocate au barreau
ATF 150 I 50 - TF 7B_471/2023 (f) du 3 janvier 2024
Couple non marié; couple; art. 8 CEDH; 10 al. 2, 13 et 36 Cst.; 84 CP; 82 al. 1 et 5 RSPC/VD; ch. 1.2 Directive interne du SPEN; règle 24 Recommandation Rec. (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes
Le droit des détenu·es aux visites intimes – sur la base du droit constitutionnel (art. 10 al. 2, 13 et 36 Cst.). Rappel de principes. La garantie de la liberté personnelle et le droit au respect de la vie privée et familiale permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée. Les restrictions s’appuient sur l’art. 36 Cst. et ses principes. Les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n’offrent pas de protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (consid. 3.2.1).
Idem – sur la base du droit international (art. 8 CEDH et règle 24 Rec. (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes). Rappel de jurisprudence, en particulier au sujet du devoir d’aider les détenu·es à maintenir un contact avec leurs familles proches. La notion de « famille » au sens de l’art. 8 CEDH est plus large que le lien marital ; elle s’appuie sur une cohabitation ou une certaine constance. L’existence d’une vie familiale est d’abord une question de fait dépendant de l’existence de liens personnels étroits (consid. 3.2.2). La CourEDH n’impose pas aux Etats contractants de prévoir des visites conjugales ou intimes, ceux-ci étant donc libres de les aménager ou non (consid. 3.2.8 et 3.2.2). Si de telles visites sont organisées, elles devraient être limitées aux proches des détenu·es (consid. 3.2.2).
Selon la règle 24 de la Recommandation Rec. (2006) 2 sur les règles pénitentiaires européennes, entre autres, les modalités des visites doivent permettre aux détenu·es de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible. Cette règle 24 n’a valeur que de simple directive, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation des libertés fondamentales (consid. 3.2.3).
Idem – sur la base du droit fédéral (art. 84 CP). Rappel de principes et précisions. L’art. 84 CP n’offre pas une protection plus étendue que le droit conventionnel et le droit constitutionnel. Selon la jurisprudence, les détenu·es n’ont pas un droit à entretenir des contacts réguliers et convenables avec d’autres personnes que leurs proches, notion dans laquelle entrent non seulement les conjoint·es, mais également les concubin·es. Bien que la notion de « proches » ne doive pas être interprétée trop restrictivement, le Tribunal fédéral l’a pour l’instant limitée. Une limitation appropriée peut intervenir dans l’intérêt du bon fonctionnement de la prison. Le Tribunal fédéral se penche pour la première fois sur le droit aux visites intimes. Comme le cercle de personnes pouvant prétendre à des visites « ordinaires » est restreint, il en est de même en ce qui concerne les visites intimes, qui, par essence sont moins fréquentes, plus difficiles à organiser et ne peuvent pas être surveillées. Selon la doctrine, de telles rencontres ne sauraient s’étendre à des personnes telles que les travailleurs ou travailleuses du sexe, puisqu’elles visent à entretenir des relations solides et durables (consid. 3.2.5).
Idem – sur la base du droit cantonal vaudois (art. 82 RSPC/VD). Les cantons sont compétents pour régir le droit de visite des détenu·es et définir quelles sont les personnes qui entrent dans la notion de « proche ». Rappel de la notion jurisprudentielle de « concubinage ». Le Tribunal fédéral précise que le terme « couple » utilisé dans l’art. 82 al. 1 RSPC/VD vise à englober des personnes pouvant se prévaloir d’un lien affectif suffisamment étroit avec la personne détenue, indépendamment du fait qu’elles vivent sous le même toit. Selon l’art. 82 al. 5 RSPC/VD et le ch. 1.2 de la directive interne du SPEN, la relation de couple donnant droit à des visites intimes doit être antérieure à l’incarcération ou avoir duré au moins six mois au moment du dépôt de la demande, afin de s’assurer que la relation sentimentale est non seulement durable, mais a suffisamment de constance. D’après le Tribunal fédéral, ces exigences du droit cantonal vaudois sont conformes au droit supérieur, respectivement à la notion de « proche » telle que les dispositions conventionnelles, constitutionnelles et fédérales la définissent (consid. 3.2.8 et 3.2.9).



Commentaire de l'arrêt ATF 150 I 50 - TF 7B_471/2023 (f)
Camille Montavon
Dre en droit, Maître-assistante, co-responsable de la Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables, Faculté de droit de l’Université de Genève
Avril 2024
ATF 150 III 153 - TF 5A_176/2023 (d) du 9 février 2024
Modification de jugement de divorce; entretien; art. 284 al. 3 CPC; 129, 285 al. 2 et 286 al. 2 CC
Modification du jugement de divorce en matière d’entretien – procédure. Rappel de principes, notamment le fait que les dispositions relatives à l’action en divorce s’appliquent par analogie à la procédure de modification de la contribution d’entretien pour l’enfant fixée dans le jugement de divorce (art. 284 al. 3 CPC), si tant est que la situation change notablement conformément à l’art. 286 al. 2 CC. A noter que l’art. 129 CC ne s’applique pas dans de telles constellations, car il traite uniquement de la modification du droit à l’entretien après le mariage (consid. 3.1).
Idem – changement important et durable de la situation (art. 286 al. 2 CC). Rappel de principes, notamment le fait que toutes les circonstances qui sont importantes pour le calcul des contributions d’entretien peuvent être prises en compte, comme par exemple les changements dans l’activité professionnelle ou la situation de logement. Une nouvelle fixation de l’obligation d’entretien ne se justifie que si le(s) changement(s) crée(nt) un déséquilibre inacceptable entre les personnes impliquées au regard du jugement de divorce initial (consid. 3.2). Rappel de principes relatifs à l’exclusion de la modification dans les cas de conventions ayant réglé une situation de fait incertaine (caput controversum) et dans lesquelles il manque une valeur de référence (consid. 3.3). Rappel que si un motif de modification est admis, tous les paramètres déterminants pour le calcul de la contribution doivent être actualisés (consid. 4.3).
Entretien de l’enfant – contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Rappel de principes, en particulier le fait que l’augmentation des revenus du parent gardien, bénéficiaire économique de la contribution de prise en charge (coûts indirects de l’enfant), ne doit pas conduire à une réattribution économique à l’enfant du montant de la contribution ainsi libérée (consid. 5.3.1 et 5.3.3). Il en va différemment des coûts directs relatifs à la prise en charge de l’enfant par des tiers (consid. 5.3.1). En raison de la méthode de calcul de la contribution de prise en charge, une augmentation du revenu du parent gardien se répercute sur le montant de la pension alimentaire. Il n’est pas important de savoir s’il s’agit d’une activité (« surobligatoire ») dépassant le modèle des degrés scolaires (consid. 5.3.2). Ainsi, en cas d’augmentation du revenu du parent gardien, bénéficiaire économique de la contribution de prise en charge, il convient d’admettre le changement durable et important et d’examiner, en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes, comment le changement intervenu se répercute sur l’obligation d’entretien (consid. 5.3.3).




Commentaire de l'arrêt ATF 150 III 153 - TF 5A_176/2023 (d)
L’amélioration de la situation financière du parent gardien comme motif de modification de la contribution de prise en charge fixée dans une convention de divorceMai 2024
ATF 150 I 88 - TF 2C_33/2023 (d) du 28 février 2024
Couple non marié; autorité parentale; procédure; art. 6 CEDH; 83 al. 1 let. j LEp; 304 al. 1 CC; 91 al. 8 let. d et al. 9 Schulgesetz/BS
Amende d’ordre pour violation de devoirs parentaux – procédure. Qualité pour recourir du parent titulaire de l’autorité parentale (art. 304 al. 1 CC), en son propre nom et au nom de l’enfant (consid. 1.3).
Idem – qualification juridique de l’amende. Rappel de principes relatifs aux critères « Engel » développés par la jurisprudence de la CourEDH en lien avec l’art. 6 CEDH, permettant de déterminer si la procédure pénale, respectivement les garanties de procédure pénale, doivent être appliquées aux amendes d’ordre dans le droit scolaire. Les mesures disciplinaires en droit scolaire d’un montant maximum de CHF 1'000.- servent à maintenir l’ordre ou à garantir le fonctionnement de l’établissement, à préserver la réputation et l’intégrité de l’institution. Elles ne constituent en principe pas des peines au sens de l’art. 6 CEDH (consid. 5.2-5.3).
En l’occurrence, la mère titulaire de l’autorité parentale n’a pas été sanctionnée en violation de la Loi sur les épidémies (art. 83 al. 1 let. j), mais en violation des obligations parentales en matière d’éducation en refusant de faire porter à sa fille un masque à l’école durant la pandémie du Covid‑19, nonobstant les prescriptions y relatives de l’époque (consid. 5.5.2). Elle a ainsi violé le droit scolaire cantonal (art. 91 al. 8 let. d et al. 9 Schulgesetz/BS) qui est de nature disciplinaire et non pénale, car il a un caractère préventif et éducatif ; il a pour vocation d’inciter le parent à respecter ses obligations, afin de préserver l’intérêt de l’enfant (consid. 5.5.2) et la sanction ne dépasse pas un montant maximum de CHF 1'000.- (consid. 5.5.3).





Commentaire de l'arrêt ATF 150 I 88 - TF 2C_33/2023 (d)
Amende disciplinaire pour violation des devoirs parentaux dans le contexte scolaireJuin 2024
ATF 150 III 160 - TF 5A_238/2023 (d) du 18 mars 2024
Couple non marié; filiation; procédure; art. 8 et 14 CEDH; 252 ss, 261 ss, 263 al. 1 ch. 2 et al. 3, 457, 470, 473 al. 1 et 522 CC; 13a al. 1 Tit. fin. CC; 7 al. 2 let. l et 8 let. l OEC
Action en réduction (art. 522 CC). Rappel de principes généraux en matière de succession et plus particulièrement au sujet des héritier·ères (consid. 4.1), de la quotité disponible (consid. 4.2) et des parts réservataires (consid. 4.3.1). Seule une partie héritière réservataire peut agir en réduction au sens de l’art. 522 CC, même si elle n’est au départ qu’une héritière virtuelle. La procédure en réduction peut effectivement déboucher sur un jugement formateur conférant la qualité d’héritier ou d’héritière, permettant ensuite d’introduire une action en partage successoral (consid. 4.3.2).
Notion de « descendant·e » en droit des successions. C’est le droit de la famille qui détermine qui est un·e descendant·e au sens de l’art. 457 CC, à savoir une personne (ou l’un·e de ses ascendant·es) qui avait un lien de filiation juridique direct avec le ou la défunt·e. Sans liens formels de droit de la famille, il n’y a pas de vocation successorale légale. Le fait que le lien de filiation soit conjugal ou extra-conjugal n’a pas d’importance. Un traitement différent est uniquement possible pour les enfants commun·es et non commun·es dans le cadre de l’art. 473 al. 1 CC en faveur du ou de la conjoint·e survivant·e (consid. 4.4).
Filiation – rappel de l’ancien droit de la filiation. Celui-ci distinguait la filiation conjugale de la filiation extra-conjugale et autorisait alors les « paternités alimentaires », lesquelles ne créaient pas de lien familial ou juridique entre le père et l’enfant, mais traitaient uniquement de l’obligation alimentaire envers l’enfant (consid. 4.5.1).
Idem – règles actuelles. Rappel des règles légales des art. 252 ss CC. L’action en paternité selon les art. 261 ss CC est une action formatrice qui permet d’aménager de manière contraignante le rapport juridique entre le père et l’enfant en le faisant rétroagir à la naissance de l’enfant, et ce, uniquement au moment du jugement, qui a en ce sens un effet formateur (consid. 4.5.3 et 7.2). Rappel que l’action en paternité doit être intentée par l’enfant au plus tard un an après sa majorité (art. 263 al. 1 ch. 2 CC) ou subséquemment en cas de justes motifs excusant le retard (art. 263 al. 3 CC) (consid. 4.5.2).
Idem – droit transitoire. Rappel que selon le droit transitoire, les « paternités alimentaires » pouvaient être adaptées au nouveau droit selon les conditions de l’art. 13a al. 1 Tif. fin. CC et n’ont pas été transformées ipso iure en « paternités avec effets d’état civil » (consid. 4.6.1).
Rappel de jurisprudences en matière d’actions en paternité tardives pour justes motifs au sens de l’art. 263 al. 3 CC, les conditions restrictives de cette disposition n’étant pas contraires à l’art. 8 CEDH (consid. 4.6.2). Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’art. 13a Tit. fin. CC contient des éléments contraires à la CEDH, comme le défend une partie de la doctrine, ou pourrait être appliqué de manière contraire à la CEDH. Il précise néanmoins qu’en autorisant les actions en paternité pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 13a al. 1 Tit. fin. CC, il veille à une application conforme à la CEDH de la disposition transitoire en question (consid. 8).
Idem – inscription dans le registre de l’état civil. Chaque relation parent-enfant est inscrite au registre de l’état civil (art. 7 al. 2 let. l et art. 8 let. l OEC). L’inscription n’a toutefois pas d’effet constitutif, mais purement déclaratif (consid. 4.7).
Paternité alimentaire et succession. Si l’enfant n’a pas intenté d’action en paternité selon le nouveau droit, il n’existe pas de filiation juridique ; l’enfant n’est par conséquent pas considéré·e juridiquement comme un·e descendant·e et n’a ainsi pas de droit successoral protégé par une réserve héréditaire (consid. 4.6.1).
A noter que si un·e enfant né·e hors mariage fait uniquement valoir des droits successoraux, ce n’est ni le droit à la « vie familiale » ni le droit à la « vie privée » qui sont en cause, mais la question de savoir s’il existe un lien juridique entre l’enfant et le ou la défunt·e. Or, l’art. 8 CEDH ne garantit pas en soi à l’enfant le droit d’être reconnu·e comme héritier ou héritière d’une personne décédée (consid. 9.1).

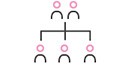



Commentaire de l'arrêt ATF 150 III 160 - TF 5A_238/2023 (d)
Sandra Hotz
Professeure ordinaire de droit civil et droit de la santé à l'Université de Neuchâtel, Dr. iur, avocate
Eté 2024
ATF 150 II 465 - TF 1C_653/2022 (d) du 3 juin 2024
Mariage; violences conjugales; art. 1 al. 1, 2 let. d et e, 13 al. 1, 14 al. 1 et 19 ss LAVI; 181 CP
Qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI – rappel de principes. Les exigences relatives à la preuve de la qualité de victime varient en fonction du moment ainsi que du type et de l’étendue de l’aide sollicitée. Un droit à l’indemnisation et à la réparation morale au sens de l’art. 2 let. d et e, et des art. 19 ss LAVI n’existe que si une infraction est établie ; en l’absence de procédure pénale pendante, l’infraction doit être prouvée sur la base de la vraisemblance prépondérante. En matière d’aide immédiate, le degré de preuve est la simple vraisemblance en raison du caractère urgent de telles aides. Une infraction est rendue vraisemblable lorsque des éléments objectifs appuient une certaine probabilité de son occurrence, même lorsque l’autorité compte encore sur la possibilité qu’elle n’ait pas eu lieu (consid. 4.1). En cas de doute, une prestation urgente d’aide aux victimes doit être fournie. C’est d’autant plus vrai pour les personnes victimes d’un préjudice exclusivement psychique qui doit être constaté dans certains cas par un examen psychiatrique minutieux. L’approche de la loi ne doit pas conduire à poser des exigences excessives en ce qui concerne la preuve de l’intensité suffisante de l’atteinte ou la description des effets individuels et concrets du comportement coercitif (consid. 4.3.1).
La qualité de victime en tant que condition d’octroi de l’aide exclut des gradations progressives de la gravité de l’atteinte en fonction du type et de l’ampleur de l’aide. La question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le recours à une aide spécifique, telle qu’un hébergement d’urgence, est approprié doit être examinée lors de l’appréciation des conditions d’octroi de l’aide immédiate (consid. 4.4). Le lien de causalité (naturelle et adéquate) est admis même si l’infraction n’est pas la seule cause de l’atteinte à l’intégrité, tant qu’il ne peut pas être écarté à tout le moins à titre de cause partielle. Une éventuelle situation (familiale) pesante ayant un impact sur l’intégrité psychique pourrait par exemple être préexistante (consid. 5.2). Dans le cadre de l’aide immédiate, le degré de preuve de la vraisemblance s’applique également à l’existence du lien de causalité (consid. 5.4).
Contrainte (art. 181 CP) et atteinte à l’intégrité psychique – rappel de principes et précisions. Une contrainte au sens de l’art. 181 CP est une infraction susceptible de porter directement atteinte à l’intégrité psychique d’une personne concernée. L’atteinte doit être d’une certaine intensité. Toute atteinte mineure au bien-être psychique ne suffit pas ; des atteintes psychiques de courte durée, ne dépassant pas le moment de l’acte, ne permettent pas de fonder la qualité de victime. Ce n’est pas la gravité de l’infraction qui est déterminante, mais le degré d’implication de la personne lésée (consid. 4.2). In casu, il existe plusieurs indices (traitement psychologique et incapacité de travail), et donc des éléments suffisants, qui permettent de conclure à une atteinte non négligeable à l’intégrité psychique de la recourante (consid. 4.3.2).
Les actes de contrainte répétés et systématiques sous forme de menaces de suicide sur une certaine période sont – du moins dans leur interaction – tout à fait susceptibles d’entraîner une atteinte non négligeable à l’intégrité psychique justifiant une demande d’aide aux victimes (consid. 4.3.3). Ce n’est pas parce que la personne concernée a finalement réussi à imposer son souhait de séparation, nonobstant les menaces de suicide la contraignant dans sa liberté, que l’on peut en déduire que l’atteinte à l’intégrité n’était pas suffisamment grave (consid. 4.3.4). Les actes de contrainte doivent être pris en compte ensemble, dans une considération globale (consid. 5.3).
Aide immédiate (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 LAVI) – logement d’urgence. Rappel de la législation (consid. 6.1). L’aide immédiate relève de mesures de premiers secours. Elle sert à couvrir les besoins les plus urgents résultant d’une infraction. Elle doit toujours être fournie lorsque la situation de la victime, directement provoquée par l’infraction, exige une mesure qui ne peut être différée, tant du point de vue matériel que temporel (consid. 6.2). Un hébergement d’urgence peut être nécessaire notamment en cas de délits relationnels. Le droit minimal à un tel logement dans le cadre de l’aide immédiate est de 35 jours selon les recommandations de la CSOL-LAVI (consid. 6.3). Le séjour en hébergement d’urgence doit relever d’une aide proportionnée (nécessaire, appropriée et adéquate) par rapport à d’autres mesures. Les conditions d’octroi doivent être rendues vraisemblables (consid. 6.4). Dans le contexte de contraintes répétées, un séjour dans un logement d’urgence est approprié pour assurer ou rétablir l’intégrité psychique de la personne concernée, par la création d’une distance spatiale (consid. 6.5).




Commentaire de l'arrêt ATF 150 II 465 - TF 1C_653/2022 (d)
Qualité de victime LAVI et octroi d’un hébergement d’urgence en cas de menaces de suicide proférées par le conjointSeptembre 2024
ATF 150 III 305 - TF 5A_801/2022 (d) du 10 mai 2024
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 126 et 163 CC; 276 CPC; 64, 66 et 68 LTF
Entretien – point de départ de l’obligation d’entretien (art. 126 al. 1 CC). Rappel des principes. Le tribunal fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due (art. 126 al. 1 CC). En principe, le moment de l’entrée en force du jugement de divorce constitue le point de départ du paiement de la contribution. Le tribunal peut néanmoins, selon son appréciation, fixer le dies a quo à une date antérieure, par exemple celle de l’entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce, c’est-à-dire lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause, et ce, même si le versement d’une contribution d’entretien a déjà été ordonné dans le cadre de mesures provisionnelles pour une période qui va au-delà de l’entrée en force partielle. Néanmoins, lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le tribunal ne saurait fixer le point de départ de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce (consid. 3.2.1).
Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes. Un revenu hypothétique peut être imputé à un·e conjoint·e, lorsqu’il ou elle n’exploite pas pleinement sa capacité de travail, pour autant qu’un tel revenu soit raisonnablement exigible et effectivement possible, conformément au principe de l’indépendance économique (consid. 4.1).
Idem – période transitoire. La période transitoire durant laquelle la contribution d’entretien est accordée est déterminée en fonction du degré de reprise ou d’extension de l’activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parties, ainsi que des autres circonstances du cas d’espèce (consid. 4.4.3).
Idem – fixation de la contribution d’entretien (art. 125 CC). Rappel des principes. Une contribution d’entretien post-divorce est due par l’une des parties, si l’on ne peut raisonnablement exiger de l’autre de pourvoir elle-même à son entretien convenable (consid. 5.1).
Idem – caractère lebensprägend du mariage. Rappel des principes. Le caractère lebensprägend ou non du mariage constitue le point de départ pour déterminer l’entretien dû (art. 125 CC), selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Un mariage est considéré avoir concrètement influencé la situation financière d’un·e conjoint·e, notamment lorsqu’il ou elle a renoncé à poursuivre sa carrière pour s’occuper du ménage et des enfants commun·es sur la base d’une décision commune, qu’il ou elle a permis à l’autre de se consacrer entièrement à sa carrière et d’augmenter son revenu, et que ledit revenu permet de financer deux ménages. En cas de mariage lebensprägend, l’art. 125 CC donne droit au maintien du dernier standard de vie commun ou, si les moyens sont insuffisants, à un niveau de vie identique pour les deux parties. Néanmoins, chacune des parties est tenue d’exploiter sa propre capacité de gain (consid. 5.2, 5.2.2 et 5.4.1).
Idem – durée de l’entretien.
Rappel des principes. Même en cas de mariage lebensprägend, il n’existe pas de droit à l’égalité financière à vie. Le critère déterminant est la durée de l’union conjugale qui peut être considérée comme une valeur indicative de la durée de l’obligation d’entretien post-divorce. En principe, plus le mariage a été bref, moins l’obligation d’entretien doit être maintenue longtemps après le divorce, et inversement. S’agissant de la partie débitrice, il est pertinent de déterminer si la répartition des tâches pratiquée pendant la vie commune a eu un effet particulièrement favorable sur sa situation économique. Concernant la partie créancière, il est déterminant d’établir si elle est en mesure ou non de retrouver sa capacité de gain hypothétique. Il convient également de tenir compte d’une incapacité de gain due à la garde des enfants. Enfin, sont également et notamment pris en compte, l’âge de la partie créancière, son état de santé, la répartition des tâches et la durée de l’interruption d’activité lucrative qui en résulte, le type de formation et d’activité professionnelle, ainsi que la durée de l’activité professionnelle antérieure à l’interruption de cette dernière (consid. 5.4.2, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.3.1 et 5.7.3.2).





Commentaire de l'arrêt ATF 150 III 305 - TF 5A_801/2022 (d)
Critères déterminants pour fixer le dies ad quem de l’obligation d’entretien fondée sur l’art. 125 CCOctobre 2024
TF 5A_336/2023 (d) du 17 juillet 2024
Divorce; partage prévoyance; art. 122, 123, 124a,124e, 247 et 251 CC; 22a, 22 et 22b LFLP; 277, 280 et 281 CPC; 30c et 30d LPP
Partage des versements anticipés pour la propriété du logement après la survenance d’un cas de prévoyance – indemnité équitable (art. 124e al. 1 CC). En cas de divorce, le versement d’une indemnité équitable à la partie créancière est prévu par l’art. 124e al. 1 CC si le partage au moyen de la prévoyance professionnelle est impossible. C’est notamment le cas lorsqu’un versement anticipé pour la propriété du logement (art. 30c LPP ; « EPL ») a eu lieu pendant le mariage, et qu’un cas de prévoyance est survenu dans l’intervalle, pour autant que le versement ne puisse pas être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Cette dernière condition est notamment réalisée lorsque les conjoint·es sont soumis·es au régime de la séparation de biens, car les fonds de prévoyance investis dans la propriété du logement ne peuvent pas être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le versement anticipé pour la propriété du logement doit alors être pris en compte par le biais de l’art. 124e al. 1 CC (consid. 4.3 et 4.3.2).
Idem – calcul de la rente supplémentaire hypothétique. L’indemnité équitable selon l’art. 124e al. 1 CC permet notamment de compenser le fait que la rente de vieillesse à partager est moins élevée en raison du fait que le capital d’épargne versé à titre de versement anticipé est sorti du circuit de la prévoyance à la suite de la survenance du cas de prévoyance. Afin de fixer cette indemnité, il convient de déterminer quelle rente supplémentaire aurait été générée par le capital de prévoyance versé de manière anticipée si le divorce avait eu lieu avant la survenance du cas de prévoyance. Dans cette hypothèse, l’art. 30c al. 6 LPP prévoit que le versement anticipé doit être considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC, ainsi que 22 à 22b LFLP. Le versement anticipé pour la propriété du logement ne rapporte pas d’intérêts. En effet, la règle de répartition proportionnelle de la perte d’intérêts (art. 22a al. 3 LFLP) implique que le versement anticipé pour la propriété du logement n’est pris en compte que dans son montant nominal, et n’est en conséquence pas actualisé lors du divorce. Le montant nominal du versement anticipé est ainsi déterminant pour la fixation de l’indemnité équitable de l’art. 124e CC (consid. 4.3.3).
Idem – capitalisation de la rente supplémentaire hypothétique. Il convient de déterminer la valeur capitalisée de la rente supplémentaire à la date déterminante pour le partage. La différence entre cette valeur et le montant du versement anticipé ne concernant que la période antérieure à la dissolution du mariage, elle demeure dans le patrimoine du preneur ou de la preneuse de prévoyance. La moitié de la valeur capitalisée de la rente constitue le point de départ pour la fixation de l’indemnité équitable de l’art. 124e CC (consid. 4.3.4).
Idem – moment déterminant pour la capitalisation. Le moment déterminant pour le partage de la rente (art. 124a CC) – c’est-à-dire le moment où la partie créancière reçoit sa part de la rente alors que celle de la partie débitrice est diminuée en conséquence – correspond à la date d’entrée en force du jugement de divorce. Cette date est également le moment déterminant pour la capitalisation de la rente supplémentaire (hypothétique) de vieillesse (consid. 4.3.5).
Idem – pondération du montant. Le montant qui serait dû à la partie créancière en cas de partage par moitié de la valeur capitalisée de la rente hypothétique doit finalement être pondéré en prenant en considération les besoins de prévoyance et la situation économique après le divorce (consid. 4.3.6).
Etablissement des faits en appel (art. 277 al. 3 CPC) – rappel des principes. L’obligation du tribunal d’établir les faits d’office (art. 277 al. 3 CPC) ne s’applique pas en procédure d’appel concernant les questions relatives à la prévoyance professionnelle (consid. 4.4.2).




Commentaire de l'arrêt TF 5A_336/2023 (d)
Anne-Sylvie Dupont
Professeure ordinaire à l'Université de Neuchâtel. Chaire de droit de la sécurité sociale. Avocate spécialiste FSA responsabilité civile et droit des assurances
Novembre 2024
TF 5A_178/2024 (d) du 20 août 2024
Divorce; autorité parentale; art. 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC; 29 al. 2 Cst.
Représentation de l’enfant devant le Tribunal fédéral – rappel. La LTF ne prévoit aucune base légale relative à la désignation d’un·e représentant·e de l’enfant dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal fédéral. Un·e représentant·e désigné·e dans la procédure cantonale peut continuer à exercer sa fonction devant le Tribunal fédéral si cela est nécessaire, et doit être indemnisé·e en conséquence (consid. 1.2).
Autorité parentale – maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Rappel des principes. Lorsqu’il doit juger de questions relatives aux enfants, le tribunal établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée, s’appliquant également devant l’instance d’appel, le tribunal a l’obligation de relever et de prendre en compte tous les faits déterminants et les circonstances juridiquement importantes qui apparaissent en cours de procédure, même si les parties ne s’y réfèrent pas (consid. 5.1).
Idem – circonstances déterminantes. Le tribunal doit statuer en se basant sur les circonstances actuelles. Lorsqu’une affaire fait l’objet d’un renvoi à l’autorité cantonale par le Tribunal fédéral, cette dernière doit actualiser les faits sur lesquels elle se base avant de rendre une nouvelle décision. Elle doit à tout le moins examiner (brièvement) si des changements importants sont intervenus. En se renseignant auprès des parties sur de tels changements, l’instance cantonale, d’une part, s’acquitte de son obligation d’actualiser les faits et, d’autre part, elle respecte le droit des parties d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 5.1).
Idem – novas. Le Tribunal fédéral, les instances cantonales et les parties sont liés par l’état de fait sur lequel se base la décision de renvoi, sous réserve de novas admissibles. L’art. 296 al. 1 CPC permet de prendre en compte ces dernières, indépendamment des restrictions de l’art. 317 al. 1 CPC, et ainsi de procéder à l’actualisation des faits exigée par la maxime inquisitoire illimitée (consid. 5.3).




Commentaire de l'arrêt TF 5A_178/2024 (d)
Représentation de l’enfant devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de séparation de ses parentsDécembre 2024
TF 9C_47/2024 et 9C_48/2024 (d) du 23 septembre 2024
Divorce; entretien; art. 3, 4, 6, 16 al. 1, 25 ss, et 35 al. 3 LIFD; 3 al. 3 et 9 al. 2 LHID
Impôt fédéral direct – déductions. Rappel. Selon la pratique, les revenus, mais également les déductions (art. 25 ss LIFD) peuvent être imposables à l’étranger et cas échéant, doivent être retirés de l’assiette de calcul de l’impôt suisse. Conformément à l’art. 35 al. 3 LIFD, les déductions sociales doivent être accordées proportionnellement en cas d’assujettissement partiel, c’est-à-dire lorsqu’une personne n’est que partiellement assujettie à l’impôt (art. 6 al. 2 LIFD) ou lorsque certains revenus d’une personne étant assujettie de manière illimitée sont exonérés (consid. 4.2 et 4.3). En l’espèce, le recourant est assujetti de manière illimitée à l’impôt en Suisse, alors que son épouse ne présente aucun lien de rattachement personnel ou économique avec la Suisse et n’est donc pas assujettie à l’impôt en Suisse. L’instance précédente a conclu à un assujettissement partiel du recourant en raison de cette relation matrimoniale internationale (consid. 5.1).
Idem – déductions des contributions d’entretien. Dans un précédent arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré que, dans le cadre d’un mariage avec ménage commun et mise en commun des ressources, les déductions telles que les contributions d’entretien doivent être réparties proportionnellement si elles ne se rapportent pas au revenu du conjoint·e domicilié·e en Suisse (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral se distancie de cette solution, qu’il admet contraire à la systématique de l’impôt sur le revenu. Ni l’obligation d’entretien de l’art. 163 al. 1 CC, ni le devoir général de fidélité et d’assistance de l’art. 159 al. 3 CC ne permettent de déduire qu’une personne est tenue de supporter le versement de contributions d’entretien dues par son conjoint·e en faveur de l’ex-conjoint·e de celui-ci ou celle-ci, en tout cas aussi longtemps que le ou la conjoint·e divorcé·e peut assumer sans difficulté financière ces contributions.
En l’espèce, les contributions d’entretien ont ainsi exclusivement grevé le patrimoine du recourant (consid. 6 et 6.1). Le Tribunal fédéral considère également qu’il est erroné de réduire la déduction pour les contributions d’entretien en raison de revenus réalisés par le ou la conjoint·e non domicilié·e en Suisse (consid. 6.2 à 6.4), ou de réduire la déduction des intérêts passifs supportés par le ou la conjoint·e assujetti·e de manière illimitée à l’impôt en Suisse sur la base des éléments fiscaux de l’autre conjoint·e (consid. 6.5).
Impôts cantonaux (et communaux) – déductions des contributions d’entretien. Comme pour l’impôt fédéral, il n’est pas possible de refuser les déductions des contributions d’entretien et des intérêts passifs sur la base des éléments fiscaux du ou de la conjoint·e domicilié·e à l’étranger (consid. 8).




Commentaire de l'arrêt TF 9C_47/2024 et 9C_48/2024 (d)
Attribution des déductions pour les contributions d’entretien et les intérêts passifs dans un contexte internationalOutil de travail à utiliser sans modération
Retrouvez tous les arrêts de la newsletter, organisés par mots-clés, sur le site www.droitmatrimonial.ch
Liste
- Newsletter Eté 2025
- Newsletter juin 2025
- Newsletter mai 2025
- Newsletter avril 2025
- Newsletter mars 2025
- Newsletter février 2025
- Newsletter janvier 2025
- Newsletter droitmatrimonial - Rétrospective 2024
- Newsletter décembre 2024
- Newsletter novembre 2024
- Newsletter octobre 2024
- Newsletter septembre 2024
- Newsletter Eté 2024
- Newsletter juin 2024
- Newsletter mai 2024
- Newsletter avril 2024
- Newsletter mars 2024
- Newsletter février 2024
- Newsletter janvier 2024
- Newsletter droitmatrimonial - Rétrospective 2023
- Newsletter décembre 2023
- Newsletter novembre 2023
- Newsletter octobre 2023
- Newsletter septembre 2023
- Newsletter été 2023
- Newsletter juin 2023
- Newsletter mai 2023
- Newsletter avril 2023
- Newsletter mars 2023
- Newsletter février 2023
- Newsletter janvier 2023
- Newsletter droitmatrimonial - Rétrospective 2022
- Newsletter décembre 2022
- Newsletter novembre 2022
- Newsletter octobre 2022
- Newsletter septembre 2022
- Newsletter été 2022
- Newsletter juin 2022
- Newsletter mai 2022
- Newsletter avril 2022
- Newsletter mars 2022
- Newsletter février 2022
- Newsletter janvier 2022
- Newsletter droitmatrimonial - Rétrospective 2021
- Newsletter décembre 2021
- Newsletter novembre 2021
- Newsletter octobre 2021
- Newsletter septembre 2021
- Newsletter été 2021
- Newsletter juin 2021
- Newsletter mai 2021
- Newsletter avril 2021
- Newsletter mars 2021
- Newsletter février 2021
- Newsletter janvier 2021
- Newsletter décembre 2020
- Newsletter novembre 2020
- Newsletter octobre 2020
- Newsletter septembre 2020
- Newsletter été 2020
- Newsletter juin 2020
- Newsletter mai 2020
- Newsletter avril 2020
- Newsletter mars 2020
- Newsletter février 2020
- Newsletter janvier 2020
- Newsletter décembre 2019
- Newsletter novembre 2019
- Newsletter octobre 2019
- Newsletter septembre 2019
- Newsletter été 2019
- Newsletter juin 2019
- Newsletter mai 2019
- Newsletter avril 2019
- Newsletter mars 2019
- Newsletter février 2019
- Newsletter janvier 2019
- Newsletter décembre 2018
- Newsletter novembre 2018
- Newsletter octobre 2018
- Newsletter septembre 2018
- Newsletter été 2018
- Newsletter juin 2018
- Newsletter mai 2018
- Newsletter avril 2018
- Newsletter mars 2018
- Newsletter février 2018
- Newsletter janvier 2018
- Newsletter décembre 2017
- Newsletter novembre 2017
- Newsletter octobre 2017
- Newsletter septembre 2017
- Newsletter été 2017
- Newsletter juin 2017
- Newsletter mai 2017
- Newsletter avril 2017
- Newsletter mars 2017
- Newsletter février 2017
- Newsletter janvier 2017
- Newsletter décembre 2016
- Newsletter novembre 2016
- Newsletter octobre 2016
- Newsletter septembre 2016
- Newsletter été 2016
- Newsletter juin 2016
- Newsletter mai 2016
- Newsletter avril 2016
- Newsletter mars 2016
- Newsletter février 2016
- Newsletter janvier 2016
- Newsletter décembre 2015
- Newsletter novembre 2015
- Newsletter octobre 2015
- Newsletter septembre 2015
- Newsletter été 2015
- Newsletter juin 2015
- Newsletter mai 2015
- Newsletter avril 2015
- Newsletter mars 2015
- Newsletter février 2015
- Newsletter janvier 2015
- Newsletter décembre 2014
- Newsletter novembre 2014
- Newsletter octobre 2014
- Newsletter septembre 2014
- Newsletter été 2014
- Newsletter juin 2014
- Newsletter mai 2014
- Newsletter avril 2014
- Newsletter mars 2014
- Newsletter février 2014
- Newsletter janvier 2014
- Newsletter décembre 2013
- Newsletter novembre 2013
- Newsletter octobre 2013
- Newsletter septembre 2013
- Newsletter été 2013
- Newsletter juin 2013
- Newsletter mai 2013
- Newsletter avril 2013
- Newsletter mars 2013
- Newsletter février 2013
- Newsletter janvier 2013
- Newsletter décembre 2012
- Newsletter novembre 2012
- Newsletter octobre 2012
- Newsletter septembre 2012
- Newsletter été 2012
- Newsletter juin 2012
- Newsletter mai 2012
- Newsletter avril 2012
- Newsletter mars 2012
- Newsletter février 2012
- Newsletter janvier 2012
- Newsletter décembre 2011
- Newsletter novembre 2011
- Newsletter octobre 2011
- Newsletter septembre 2011